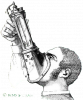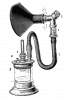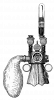Peter Safar (1924-2003) [Fig. 1], l’un des principaux promoteurs de la RCP est né à Vienne.

Il a obtenu son diplôme de docteur en médecine dans cette ville en 1948. En 1949 il obtient une bourse pour effectuer un fellowship à l’Université de Yale (New Haven, Connecticut, USA) [1]. En 1950 il émigre définitivement aux États-Unis. Après Philadelphie et Lima au Pérou, il est recruté en 1954 comme instructeur en anesthésiologie à Baltimore (Maryland), d’abord au John Hopkins Hospital puis au Baltimore City Hospital. En 1961 il est nommé professeur d’anesthésiologie et de réanimation à l’Université de Pittsburgh. P. Safar s’intéresse au maintien de la ventilation lors des arrêts respiratoires. Par des essais cliniques il démontre que la ventilation par bouche à bouche permet une oxygénation suffisante chez un sujet en apnée [8,9]. Parallèlement James Elam [Fig. 2] à Buffalo (New York, USA) et Elwyn S. Brown à Saint-Louis (Missouri, USA) ont montré que l’air expiré insufflé à un sujet via un tube endotrachéal ou un masque facial contient suffisamment d’oxygène pour maintenir une oxygénation suffisante chez le sujet en apnée [3, 10]. En 1956 P. Safar et J. Elam lors d’une rencontre au congrès de l’American Society of Anesthesiologists (ASA) à Kansas City confrontent leurs résultats et décident de diffuser la technique de réanimation ventilatoire notamment en développant des techniques d’enseignement adaptées au personnel médical, paramédical et à la population générale.
En 1958 au congrès de la Scandinavian Society of Anaesthesiologists à Gausdal en Norvège P. Safar a présenté pour la première fois à un congrès médical sa recherche et celle de J. Elam sur la méthode du bouche-à -bouche comme technique de réanimation de l’arrét cardiaque. En Norvège, en raison de la grande longueur des côtes et de la fréquence des noyades, dès 1939 un enseignement des gestes de survie a été prodigué aux élèves dès l’école primaire. À l’époque c’est la technique de Holger Nielsen qui était enseignée. La nouvelle méthode a d’emblée posé le problème de son enseignement pratique à grande échelle. Par exemple P. Safar a réalisé les essais cliniques du bouche à bouche chez des volontaires sous sédation (péthidine, scopolamine) et curarisés avec la succinylcholine [Fig. 3].

Ainsi les pompiers de Baltimore ont été formés à la technique à l’occasion d’une démonstration unique sur volontaire. Archer Gordon membre de l’American Heart Association’s CPR Committee a reconnu que l’entraînement à la RCP par des exercices réalisés par les étudiants entre eux comportait un risque de traumatisme, notamment de fractures de côtes. Il est donc apparu que pour des raisons éthiques ceci ne pouvait pas permettre une formation à grande échelle.
À la suite du congrès de 1958 Bjorn Lind, anesthésiste à l’hôpital de Stavanger (Norvège) a démontré l’efficacité du bouche à bouche, pratiqué par les chirurgiens, chez les patients chirurgicaux sous anesthésie générale. Pour faire une démonstration de la technique aux médecins des environs de Stavanger, B. Lind a pratiqué la méthode sur un adolescent devant subir une intervention mineure. La démonstration eut un tel succès que l’auteur fut invité dans les différents hôpitaux de la région. Dans l’hôpital de Haugeslund le chirurgien a refusé que la démonstration soit faite sur un de ses patients. Lors d’une réunion scientifique ultérieure B. Lind a alors pratiqué la technique sur son épouse qui pour la démonstration a reçu une anesthésie générale avec thiopental et succinylcholine (curare). Cependant il était évident que ces méthodes de démonstration ne pouvaient pas être généralisées surtout si un grand nombre de personnes devaient être formées. C’est à cette période qu’est intervenu Asmund Laerdal (1913-1981) [Fig. 4].
Il est fabricant de jouets et la poupée Laerdal dénommée Anne est très populaire en Norvège [Fig. 5].
Pour la fabrication de la poupée il a développé un plastique souple dont la technique de fabrication a été rapportée par lui lors d’un voyage aux États-Unis en 1949. A. Laerdal était membre de la Croix Rouge locale et était intéressé par les gestes de premiers secours car il avait sauvé de la noyade son jeune fils quelques années auparavant. Au courant de la nouvelle technique du bouche à bouche et des problèmes soulevés par son enseignement à un grand nombre de sujets. Il a pris contact avec B. Lind et lui a proposé la fabrication d’un mannequin de la taille d’un sujet adulte qui comporterait des voies aériennes permettant de simuler le bouche à bouche [17, 18] [Fig. 6 et 7].
B. Lind a été étroitement associé à la réalisation du prototype, ce qui a pris environ un an. Le mannequin a été testé chez 6 900 enfants d’écoles primaires [19]. Ayant donné satisfaction A. Laerdal a fait le voyage à Baltimore et New York pour présenter le mannequin à P. Safar, J. Elam et A.S. Gordon conseiller de la Croix Rouge américaine. Les interlocuteurs furent enthousiastes. Pour le modèle définitif A. Laerdal a pensé que le visage d’une jeune fille serait moins intimidant pour les étudiants. Il s’est souvenu d’une reproduction de l’Inconnue de la Seine accrochée dans la maison de ses grands-parents et c’est ainsi que le visage de Resusci Anne est la copie de celui de l’Inconnue de la Seine [Fig. 8 et 9].
Le don de 650 mannequins par un groupe de banques norvégiennes a permis de diffuser la technique dans les écoles norvégiennes et les résultats sont été publiés par G. Lind [19]. Le mannequin est présenté officiellement à un symposium international sur la réanimation organisé à Stavanger en Norvège et les présentations scientifiques sont publiées dans les Acta Anaesthesiologica Scandinavica [20].
Aux États-Unis deux ingénieurs, Guy Knickerbocker et William Kouwenhoven et le docteur James Jude ont développé le massage cardiaque externe (MCE) [21]. Le mannequin Laerdal est modifié pour permettre d’associer le massage cardiaque externe au bouche à bouche. La famille des mannequins de réanimation Laerdal (Resusci Anne, Resusci Andy, Resusci Baby) est née et sera un succès commercial qui persiste jusqu’à nos jours.
Sur les traces de l’Inconnue de la Seine
Mais qui était cette Inconnue de la Seine qui a prêté son visage au mannequin Resusci-Anne ? [Figure 10].
C’est autour de 1900 que le masque dit de L’Inconnue de la Seine est l’objet de descriptions par des écrivains et des artistes. Richard Le Gallienne (1866-1947), auteur anglais, publie en 1900 un livre écrit en 1898 intitulé The Worshipper of the image (L’Adorateur de l’image) [22]. Le masque ornait l’un des murs de son bureau. Ce roman, peu diffusé à l’époque, décrivait l’emprise qu’exerçait le masque sur la vie d’un poète à l’esprit fragile. Rainer Maria Rilke est arrivé à Paris en 1902 et a séjourné 3 rue de l’Abbé-de-l’Épée proche de la rue Racine. Dans les Cahiers de Malte Laurids Brigge (publication allemande en 1910, publication de la traduction française en 1923) il mentionne le masque de l’Inconnue associé à celui de Beethoven, dans la vitrine du mouleur Lorenzi, rue Racine.
« Le mouleur devant la boutique duquel je passe tous les jours a accroché deux masques devant sa porte. Le visage de la jeune femme noyée que l’on moula à la morgue, parce qu’il était beau et parce qu’il souriait, parce qu’il souriait de façon si trompeuse. ». [23 page 72 édition Points] [Figure 11].
Néanmoins, le masque est plus ancien puisque une des premières traces du masque est trouvée dans le Cours de dessin de Charles Bargue et Jean-Léon Gérome publié en 1867 [24]. La planche 53 est intitulée Jeune femme-Moulage d’après nature [Figure 12].
La légende de la planche indique : masque mortuaire d’une noyée. C’est ainsi que dès la deuxième moitié du XIXe siècle naît la légende de la noyée dont le masque aurait été pris sur le cadavre par un employé de la Morgue de Paris qu’avaient touché la beauté de son visage, son absence d’identité, son destin tragique et son sourire troublant. La dénomination de L’Inconnue de la Seine est assez tardive et date sans doute du recueil de photographie d’Ernst Benkard en 1926 [25, 26]. L’Inconnue de la Seine aura de nombreuses dénominations : Mona Lisa de la Seine en raison de son sourire mystérieux, « Joconde du suicide » (Aragon).
Le roman de Rilke attire l’attention sur le mouleur Lorenzi établi rue Racine à Paris (l’Atelier Lorenzi sera transféré au 60, Avenue Laplace 94110 Arcueil en 1942). Michele Lorenzi un expert en plâtre et en stuc est originaire de Toscane en Italie. Émigré en France il a ouvert une boutique à Paris en 1871 au n°19 de la rue Racine. C’est lui qui réalise les premières copies du masque. Les copies du masque en plâtre ont été initialement utilisées comme modèle à l’école des Beaux-Arts. Au XIXe siècle les étudiants utilisaient des « têtes d’expression » pour leurs apprentissage de la sculpture [27, 28].

Figure 13. Le moule des Ateliers Lorenzi
|

Figure 14. Ateliers Lorenzi à Arcueil.
|
Le moule actuel de l’Atelier Lorenzi n’est sans doute pas le moule d’origine et daterait de 1895-1900 [Figures 13 et 14].
Il faut rappeler que la deuxième moitié du XIXe siècle est marquée par la mode des masques mortuaires des artistes et des grands hommes politiques (Pascal, Voltaire, Goethe, Beethoven, Napoléon ou Wagner) [29]. Les Lorenzi datent le masque des années 1860 car la coiffure en bandeaux à la mode sous le Second Empire est en faveur de cette date.
La technique du moulage du visage a été utilisée dès la Renaissance avec un développement important au XIXe siècle qui en marque son apogée [30, 31] [Annexe 1]. L’activité de moulage n’a jamais été considérée comme une activité artistique bien que sa technique ait demandé beaucoup d’habileté. C’est ainsi que certains mouleurs avaient acquis une réputation d’excellence et étaient sollicités pour mouler les masques mortuaires de personnalités célèbres. Le Manuel Roret du mouleur édité en 1838 a été le manuel de référence pendant tout le XIXe siècle [31]. Il a été régulièrement réédité jusque dans les années 1920 et plusieurs éditions sont accessibles sur le site Gallica de la BnF [Figure 15].
Le moulage doit se faire avant la rigidité cadavérique qui s’accompagne de modifications des contours du visage (les joues se creusent, les yeux s’enfoncent, le nez et la bouche se dépriment). De plus les oreilles ne sont pas moulées.
De nombreux écrivains, artistes et journalistes ont cherché à découvrir la vraie identité de cette inconnue [32, 33]. Les recherches dans les archives de la Préfecture de Police de Paris ont été infructueuses [32]. Les archives de la morgue de Paris avant son déménagement au début du XXe siècle ont disparu [Annexe 2] [Fig. 16 et 17].
Le plus vraisemblable est qu’il s’agisse du masque réalisée chez un modèle d’artiste. Ainsi l’artiste Georges Villa tenait de son maître Jules Lefèvre (1836-1911) que l’Inconnue de la Seine était une jeune modèle qui mourut poitrinaire vers 1875. A l’analyse il est évident que le masque ne peut pas être celui d’une noyée comme le voudrait la légende. Ses traits fins et délicats n’ont rien de ceux bouffis des cadavres repêchés dans la Seine. Les médecins légistes savent qu’en quelques heures, l’eau boursoufle les visages, putréfie les chairs et rend les faces méconnaissables. Les mêmes informations sont fournies en 2013 à un journaliste de la BBC par le brigadier Pascal Jacquin de la brigade fluviale de Paris [34]. La seule information solide vient du mouleur de la rue Racine, la famille Lorenzi. En 1960, pour la revue Chercheurs et Curieux Pierre Lièvre avait interrogé l’arrière grand-père de l’actuel mouleur, qui faisait remonter l’histoire à son propre grand-père lequel aurait lui-même moulé l’Inconnue à la demande d’un médecin légiste [cité dans le blog des éditions Cousu Main L’Inconnue de la Seine 28 mars 2020 ; cousumain.worldpress.com]. Le journaliste Jean Ducourneau, pour rédiger sa note sur L’Église de Céline (cf ci-dessous) [35, 36] va à son tour rue Racine où le petit-fils rectifie les propos du grand-père. Son père lui avait toujours dit que le masque « avait été levé sur le visage d’un très joli modèle d’atelier, rappelant qu’il est techniquement impossible que ce masque ait été levé sur un cadavre » (en effet très rapidement la rigidité cadavérique bloque l’articulation mandibulaire et le sourire aurait plutôt été un rictus ou une grimace).
En 1945 Marius Grout (1903-1946) a publié Poèmes à l’Inconnue aux éditions du Seuil. Le recueil de poèmes est illustré avec des photographies du masque par Marcel Bovis (1904-1997) [33]. À cette occasion l’éditeur du Seuil, Paul Flamand aurait identifié le mouleur du masque d’origine, mais au moment de le contacter il apprend son décès brutal. Ainsi l’ouvrier emporte le secret dans sa tombe. Les recherches ultérieures de Marius Grout restèrent elles aussi infructueuses. « Le masque de l’Inconnue de la Seine est donc une œuvre sans auteur, un document historique, ... en méme temps qu’un objet mystérieux et troublant devenu mythique, dont les silences et les résistances sont indéfiniment interrogés » [28].
Le masque a été abondamment et continûment diffusé par les mouleurs, les graveurs, les photographes et les éditeurs de cartes postales [Fig. 18 et 19] .
Il a eu du succès dans le Paris bohème du début du XXe siècle. Il ornait paraît-il, un grand nombre d’intérieurs bourgeois au début du XXe siècle. Dans les années 1920-1930 il est abondamment diffusé en Allemagne à la suite de la publication du livre de Benkard [25] [Fig. 20].
L’expressionnisme allemand et le surréalisme français se sont approprié le masque. Vers 1930, une génération de jeunes Allemandes influencées par l’actrice Elisabeth Bergner (1897-1986) ont adopté son genre de coiffure. E. Bergner fascinée par l’Inconnue de la Seine, a copié sa coiffure courte et symétrique dégageant le front large, aux bandeaux ramenés sur les tempes et les oreilles, selon la mode du second empire [Fig. 21].
Dans l’article qu’elle consacra au masque en 1931, Herta Pauli notait qu’à Berlin « les copies du moulage sont partout et on les achète toujours régulièrement » [37]. Dans les années 1930 et 1940, le masque de l’Inconnue s’est trouvé fortement inscrit dans l’imaginaire surréaliste (André Breton, Aragon, Éluard, Man Ray, Giacometti). Comme un emblème ou un totem, le masque est accroché sur les cimaises de l’exposition surréaliste « Le réve dans l’art et la littérature » organisée en 1939 à Paris.
René Vautrin dans l’Inconnue de la Seine, article paru dans L’Intermédiaire des chercheurs et des curieux (n° 195, juin 1967, pp.550-1) [38] cite un article de La Presse en 1951 :
« Tous les touristes étrangers ne quittent pas la capitale en fourrant dans leurs valises une tour Eiffel de vingt centimètres de haut, un presse-papier représentant l’Arc de Triomphe ou un Sacré-Cœur en miniature. Beaucoup emportent en souvenir de leur visite à Paris quelques belles reproductions d’un des innombrables chefs-d’œuvre conservés dans nos musées, ou un moulage, toujours le même, l’Inconnue de la Seine ».
L’Inconnue dans la littérature
La vie de cette femme sans passé et sans regard va être inventée, construite et enjolivée par nombre d’auteurs. Ainsi de nombreuses légendes sont nées. Pour John Goto (né en 1949) artiste photographe d’Oxford l’Inconnue serait une artiste de music-hall hongroise Ewa Lazlo tuée par son amant [in Loke 34]. L’Inconnue a aussi été identifiée comme étant la fille d’un mouleur de masque mortuaire de Hambourg ou encore à une jeune française du nom de Valérie qui se serait mariée à un Anglais à Saint-Pétersbourg et dont la tombe se trouverait au Père Lachaise. Autant d’histoires qui ne sont que pure affabulation.
Après la publication de Rilke de nombreux écrivains ont fait de l’Inconnue le motif et parfois même le personnage de nouvelles, de romans, de poèmes et de pièces de théâtre.
En 1929, Alfred Dà¶blin (1878-1957) l’évoque longuement dans son essai sur l’œuvre photographique d’August Sander [39].
En 1931, Jules Supervielle (1884-1960) qui possédait un masque dans son bureau écrit un conte l’Inconnue de la Seine où, pour la première fois l’histoire de la jeune fille représentée par le masque est racontée. Ce conte est une des nouvelles du recueil intitulé L’Enfant de la haute mer [40] [Fig. 22].
En 1931, l’actrice et romancière allemande Hertha Pauli (1906-1973) publie dans un quotidien, le Berliner Tageblatt, une nouvelle où elle reprend le titre de L’Inconnue de la Seine. C’est l’histoire d’une jeune fille de 20 ans qui se noie à la suite d’une déception amoureuse [37]. En 1933 l’Inconnue est le personnage d’une pièce de théâtre de Ödön von Horvath (1901-1938) [41]. En 1933 Alfred K. Wiedemann (1856-1936) publie un récit intitulé L’Inconnue de la Seine [42].
En 1933, en frontispice de l’édition de luxe de sa pièce de théâtre L’église, ayant refusé de voir sa propre photographie publiée, Louis-Ferdinand Céline fait reproduire une photographie du masque de l’Inconnue de la Seine diffusée par l’éditeur berlinois Amsler et Ruthardt [35, 36] [Fig. 23].
Céline ne connaissait pas l’histoire de ce masque et c’est Léon Deffoux journaliste et critique littéraire à la publication L’œuvre, qui à la suite de son analyse de la pièce de Céline, a reçu un abondant courrier des lecteurs. Ceux-ci indiquaient que ce masque était connu bien avant 1930. Des étudiants des Beaux-Arts soulignaient que ce masque appartenait à la décoration de leurs chambres et de leurs ateliers depuis plusieurs générations successives. C’est ainsi qu’Alfred Alvarez a pu écrire « Au cours des années 1920 et au début des années 1930, sur tout le continent, presque chaque étudiant doué de sensibilité avait un plâtre de son masque mortuaire : un visage jeune et plein, au doux sourire, qui semblait n’être pas mort, mais dormir paisiblement » [43].
Le roman Die Unbekannte (1934) de Reinhold Conrad Muschler (1882-1957) qui a été un immense succès public comporte la photographie du masque en frontispice [Fig. 24].
L’héroïne du roman, Madeleine Lavin est une jeune provinciale qui arrive à Paris et tombe amoureuse d’un jeune lord anglais. Le jeune lord déjà fiancé l’abandonne pour rejoindre sa fiancée en Égypte. Elle se jette dans la Seine à l’endroit de leur première rencontre. Le succès considérable de cette histoire un peu mièvre vendue en huit langues différentes a été adaptée au cinéma dans un film de Frank Wysbar dont Muschler fut scénariste.
Vladimir Nabokov (1899-1977) qui se trouve à Berlin au moment de la parution du roman de Muschler publie deux mois plus tard en 1934, dans une revue pour russes émigrés, un poème intitulé également L’Inconnue de la Seine [45, Annexe 3]. Un article sur Nabokov et son poème est publié dans le numéro 791 (1995) de la revue Europe. Ce numéro est entièrement consacré à Vladimir Nabokov.
En 1936 Claire Goll publie une nouvelle Die Unbekante aus der Seine, dans laquelle le personnage principal plonge le regard sur un masque mortuaire et meurt d’une crise cardiaque causée par le chagrin et la culpabilité, croyant reconnaître le visage de sa fille [46].
En 1944 Aragon publie le roman Aurélien dans lequel le masque de l’Inconnue de la Seine joue un rôle important [47] [Annexe 4] [Fig. 25].
En 1944 Anaïs Nin évoque l’Inconnue dans une nouvelle [48].
En 1962 Julio Cortàzar (Argentine) dans une courte nouvelle de 3 pages "El rio" (Le Fleuve) fait allusion à l’Inconnue à l’occasion d’un suicide par noyade. En 1963 le même auteur refait allusion à l’Inconnue dans un roman expérimental Rayuela (titre anglais Hopscotch, dont la traduction française est marelle) [49]. Ce roman a été écrit à Paris, publié en espagnol en 1963 et en anglais en 1966. En 1968 dans un roman intitulé L’Inconnue de la Seine Jacques Brenner (1922-2001) raconte l’enquête policière de l’assassinat d’une jeune fille étranglée sur les berges de la Seine à proximité du pont des Arts [50]. Maurice Blanchot publie un essai Une voix venue d’ailleurs en 1992 sur les poèmes de Louis-René des Foréts et repris dans Une voix venue d’ailleurs (Gallimard 2001) comportant divers autres essais [51] [Fig. 26].
Il écrit :
« Quand je résidais à Èze, dans la petite chambre (agrandie par une double perspective, l’une ouverte jusqu’à la Corse, l’autre par-delà le cap Ferrat où je demeurais le plus souvent, il y avait (elle y est encore), pendue au mur, l’effigie de celle qu’on a nommée l’Inconnue de la Seine, une adolescente aux yeux clos, mais vivante par un sourire si délié, si fortuné, (voilé pourtant), qu’on eût pu croire qu’elle s’était noyée dans un instant d’extrême bonheur. Si éloignée de ses œuvres elle avait séduit Giacometti au point qu’il recherchait une jeune femme qui aurait bien voulu tenter à nouveau l’épreuve de cette félicité dans la mort. »
Un roman pour enfant L’inconnue de la Seine est publié en 1997 par Cohen-Scali S. [52]. L’Inconnue est évoquée dans la première histoire Des Inconnues, roman de Patrick Modiano [53]. Marie Etienne en 2004 dans le roman L’Inconnue de la Loire recherche les causes de la noyade d’une femme dans la Loire [54]. L’Inconnue de la Seine de Didier Blonde, roman publié en 2012 est une fiction qui mélange des faits réels et imaginaires [32] [Fig. 27].
Guillaume Musso en 2021 publie un roman intitulé L’Inconnue de la Seine qui n’a qu’un rapport lointain avec le masque, mais le titre n’a sans doute pas été choisi au hasard, exploitant l’attirance persistante de la légende [55].
Dans la littérature américaine l’Inconnue fait des apparitions dans diverses œuvres.
Dans le roman The Recognitions de William Gaddis analysé par Anja Zeidler [56]. En 1999 John Straley publie un roman The Angels Will Not Care dans lequel il décrit un club dénommé L’Inconnue de la Seine
dont les membres sont atteints de maladies incurables et veulent se suicider. Chuck Palahniuk dans le roman Haunted (2005) utilise Resusci Anne qui est appelée Breather Betty dans la nouvelle Exodus. En 2002 Caitlin R. Kiernan publie une fiction fantastique The Drowning Girl écrite à propos du modèle Resusci Anne.
En poésie outre Nabokov, Marius Grout publie Poèmes à l’Inconnue (1945) illustrés de photographies du masque par Marcel Bovis (1904-1997) [33]. René-Guy Cadou publie un recueil de poésies qui inclut un poème L’Inconnue de la Seine [57]. Glücksmann Bernard, dit Stanislas Rodanski (1927-1981), est un poète et romancier surréaliste français. Deux poèmes parus dans le recueil posthume Je suis parfois cet homme (Gallimard, 2013), évoquent, dès leur incipit, l’Inconnue de la Seine : « L’inconnue de la Seine en souriant est passée » (p. 129), et le poème Héroïne (p. 137) qui commence ainsi : « Demeure Inconnue de la Seine / étrangère à la pluie nomade / En souvenir de mon absence » [58]. Céline Walter en 2016 dans le recueil de poésies titré L’Inconnue de la Seine repêche dans les eaux de la Seine le destin croisé de trois noyées [59].
L’Inconnue dans la photographie
On trouve la reproduction photographique du masque de l’Inconnue de la Seine dans de grands livres consacrés aux masques mortuaires publiés à la fin des années 1920 tels ceux de Egon Friedell, Richard Langer ou Fritz Eschen. Aucun de ceux-ci n’a atteint le succès du livre d’Ernst Benkard dont la première édition date de 1926 [25]. Ernst Benkard collectionneur de masques mortuaires (Toten Masken) plaça l’Inconnue de la Seine sur la couverture de son recueil de masques mortuaires, Das ewige Antlitz (Le Visage éternel) [Fig. 20].
Le livre connut un grand succès en Allemagne (19 éditions) et en Angleterre. Dans son livre E. Benkard fait l’historique de 123 masques, tous reproduits photographiquement.
D’autres photographes se sont intéressés à l’Inconnue. Augustine H. Folsom (1870-1926) à Bosten en 1890 publie une photographie d’une artiste reproduisant le masque de l’Inconnue [60] [Fig. 18].
Albert Rudomine (1872-1975), connu pour ses représentations de nus et de sculptures, exécuta un portait de l’Inconnue de la Seine qu’il intitula La Vierge inconnue, canal de l’Ourcq (1927) amalgamant le masque en plâtre, le visage de la Vierge et des suicides de femmes dans le canal de l’Ourcq. À la même époque sous le titre Ophélie (l’Inconnue de la Seine) Rudomine conçut aussi un photomontage où le masque de l’Inconnue de la Seine flotte entre deux eaux [26, 28, 30] [Fig. 28].
En 1929, Yvonne Chevalier humanise l’Inconnue ; le masque est remplacé par un vrai visage de femme apparaissant à fleur d’eau et intitulé, bien sûr, L’Inconnue de la Seine [Fig. 29].
Willy Zielke (1902-1989) photographe qui appartient à la Nouvelle Objectivité, en 1934 photographie le masque enveloppé dans du papier de soie. Man Ray (1890-1976) à diverses périodes de son activité a utilisé le masque dans ses œuvres [Annexe 4, Fig. 30-32].

L’Inconnue dans la sculpture et la peinture
Le masque a influencé la photographie et le cinéma mais il est peu présent dans la sculpture et la peinture. Ceci tient en partie au fait qu’au XIXe siècle les mouleurs n’étaient pas considérés comme des artistes mais plutôt comme des artisans. Il faut cependant noter que certains sculpteurs avaient acquis une expertise dans le moulage et ceci explique qu’ils aient été sollicités pour la réalisation du masque mortuaire de personnalités politiques ou du monde des arts.
Dans la sculpture pratiquement le seul cas d’utilisation du masque de l’Inconnue est le monument de Dépleschin (1852-1926) réalisé vers 1900 et dédié à Alexandre Desrousseaux (1820-1892) compositeur populaire lillois qui a composé le P’tit Quinquin [Fig. 33].
Le plâtre est conservé au musée des Beaux-Arts de Lille.
Le masque est utilisé en 1990 par un artiste plasticien suisse Daniel Spoerri dans un assemblage de débris [Daniel Spoerri L’Inconnue de la Seine, assemblage, 1990, Vienne, Sammlung Bank für Arbeit und Wirtschaft]. Dans cet assemblage le masque de l’Inconnue de la Seine est inséré dans un amas d’objets de récupération en bois et en métal notamment des roues et des bordures [Fig. 34].
En 2016 la Tôlerie de Clermont-Ferrand présente une exposition collective d’art contemporain entièrement consacrée au personnage de l’Inconnue dans laquelle l’artiste Guillaume Constantin fait de la jeune femme un de ses sujets préférés. En 2019 l’Inconnue est utilisée par Guillaume Constantin dans une exposition de la FRAC à Montpellier (Ladies Elect II) [Fig. 35].

L’apparition de l’Inconnue de la Seine dans la peinture est exceptionnelle. On peut citer un tableau de Frans Haest (1902-1977), peintre à Anvers et dont une peinture à l’huile sur toile 66 x 56 cm est intitulée La noyée de la Seine. Ce tableau est présent au catalogue général de la BnF (site Richelieu). La consultation de cette œuvre est soumise à autorisation et rendez-vous auprès de la Réserve du département des Estampes. Dans sa thèse F. Petiot signale une ressemblance avec l’Inconnue dans le tableau Madame Armand (1902) du peintre Albert Besnard (1849-1934) [61]. L’histoire fantasmée de cette mystérieuse noyée est associée à Ophélie aussi bien qu’à Ondine. Si au XIXe siècle de nombreux peintres ont illustré cette héroïne romantique aucun ne s’est directement inspiré du masque de l’Inconnue. On peut citer Eugène Delacroix qui a consacré à Ophélie trois tableaux et une lithographie. Le tableau le plus célèbre est celui de John Everett Millais [Fig. 36] pour lequel, pendant l’hiver 1852, le peintre a longuement fait poser son modèle Elizabeth Siddal dans une baignoire, afin d’observer le déploiement des vêtements au ras de l’eau.
L’Inconnue dans le théâtre et le cinéma
Outre la pièce de théâtre d’Ödön von Horvath on peut citer plus récemment le spectacle vivant de Pierre Sabryna L’Inconnue de la Seine intitulé Opéra miniature pour une soprano et un comédien et un ensemble instrumental (clarinette, violon, violoncelle, contrebasse, trombone) [62].
Au cinéma une allusion plus ou moins précise à l’Inconnue est faite dans les films suivants : Jean Vigo L’Atalante (1934) ; le film allemand Unbekannte de Frank Wisbar (1936) tiré du roman de Muschler (1934) ; Max Ophüls Lettre à une inconnue (1948) ; Georges Franju Les Yeux sans visage (1959). Un téléfilm de l’ORTF d’Olivier Ricard est intitulé L’Inconnue de la Seine (Site Internet INA : https://madelen.ina.fr/programme/linconnue-de-la-seine). L’intrigue policière concerne une jeune fille qui est retrouvée étranglée au bord de la Seine.
Le masque apparaît à l’écran dans le film La Mariée était en noir (1968) de François Truffaut [Fig. 37].
En 1987 Agnès Varda dans le film consacré à Jane Birkin (Jane B. par Agnès V., Arte éditions) à la 43e minute du film elle évoque le masque de l’Inconnue de la Seine qui apparaît à l’écran (A. Varda possède une copie du masque) [Fig. 38-40].

Alain Resnais dans une interview rapporte l’impact de l’Inconnue sur son travail [63]. La présence de l’Inconnue est élusive dans de nombreux de ses films : Je t’aime, je t’aime (1968), Stavisky (1974), Mon Oncle d’Amérique (1980), Mélo (1986), On connaît la chanson (1997), Les Herbes folles (2008). Peter Greenaway en 1988 intitule un court métrage Les Morts de la Seine (44 min). Le court métrage (11 min) d’Alexandre Nahon et Jean-Pierre Larcher sur l’Inconnue tourné en 1990 obtient un prix en 1992 à la Biennale Internationale du Film sur l’Art au Centre Georges Pompidou (Paris).
Ainsi donc le masque de l’Inconnue de la Seine reste très présent dans l’imaginaire collectif comme en témoignent les nombreux articles et vidéos récents dans les médias (quotidiens, hebdomadaires, télévision, émissions radiophoniques). Le site YouTube permet de visionner de nombreux documentaires, courts métrages, vidéos artistiques ayant pour sujet L’Inconnue de la Seine. À Paris un site propose un jeu de rôle type Escape Game qui se déroule sur les lieux supposés de la noyade de l’Inconnue [64] [Fig. 41].
Références
- 1. Baskett PJ. Peter J. Safar, the early years 1924-1961, the birth of CPR. Resuscitation 2001 ; 50 : 17-22.
- 2. Baskett PJ. Peter J. Safar. Part two. The University of Pittsburgh to the Safar Centre for Resuscitation Research 1961-2002. Resuscitation 2002 ; 55 : 3-7.
- 3. Matioc AA. An anesthesiologist’s perspective on the history of basic airway management : the "progressive" era, 1904 to 1960. Anesthesiology 2018 ; 28 : 254-71.
- 4. Fontanella JM. Peter Safar. Histoire de la Réanimation CardioPulmonaire (RCP). Conférence Club de l’Histoire de l’Anesthésie et de la Réanimation (CHAR). 2020 . Accessible sur le site char-fr.net
- 5. Trubuhovich RV. History of mouth-to-mouth ventilation : Part 3. The 19th to mid-20th centuries and "rediscovery". Crit Care Resusc 2007 ; 9:221-37. Accès libre via Internet
- 6. Safar P. Mouth to mouth airway. Anesthesiology 1957 ; 18 : 904-6.
- 7. Safar P, Elam J. Manual versus mouth-to-mouth methods of artificial respiration. Anesthesiology 1958 ;19:111-2.
- 8. Safar P. Ventilatory efficacy of mouth-to-mouth artificial respiration : Airway obstruction during manual and mouth-to-mouth artificial respiration. J Am Med Assoc 1958 ; 167:335-41.
- 9. Safar P, Escarraga LA, Elam JO. A comparison of the mouth-to-mouth and mouth-to-airway methods of artificial respiration with the chest-pressure arm-lift methods. N Engl J Med 1958 ; 258:671-7.
- 10. Elam JO, Brown ES, Elder JD. Artificial respiration by mouth to mask method. A study of the respiratory gas exchange of paralyzed patients ventilated by operator’s expired air. N Engl J Med 1954 ; 250 : 749-54.
- 11. Gordon AS, Frye CW, Gittelson L, Sadove MS, Beattie EJ Jr : Mouth-to-mouth versus manual artificial respiration for children and adults. J Am Med Assoc 1958 ; 167:320-8.
- 12. Poulsen H, Skall-Jensen J, Staffeldt I, Lange M. Pulmonary ventilation and respiratory gas exchange during manual artificial respiration and expired-air resuscitation on apnoeic normal adults : A comparison of the Holger Nielsen method and the mouth-to-mouth method. Acta Anaesthesiol Scand 1959 ; 3:129-53
- 13. Safar P. Closed chest cardiac massage. Anesth Analg 1961 ; 40 : 609-13.
- 14. Lind B. The birth of the resuscitation mannequin, Resusci Anne, and the teaching of mouth-to-mouth ventilation. Acta Anaesthesiol Scand 2007 ; 51 : 1051-3.
- 15. Gordetsky JB, Rais-Bahrami S, Rabinowitz R. Annie, Annie ! Are you okay ? : Faces behind the Resusci Anne Cardiopulmonary Resuscitation Simulator. Anesth Analg 2020 ; 131 : 657-9.
- 16. Breivik H. Comments and correction to "Annie, Annie ! Are you OK ? Faces Behind the Resusci Anne Cardiopulmonary Resuscitation Simulator". Anesth Analg 2020 ; 131 : e264.
- 17. Tjomsland N, Baskett P. Asmund S. Laerdal. Resuscitation 2002 ; 53 : 115-9.
- 18. Tjomsland N, Laerdal T, Baskett P. Resuscitation great : Bjorn Lind-the ground-breaking nurturer. Resuscitation 2005 ; 65 : 133-8.
- 19. Lind B. Teaching mouth to mouth resuscitation in primary schools. Acta Anaesthesiol Scand Suppl 1961 ; 3 : 63-6.
- 20. Poulsen H., ed. Emergency resuscitation. Acta Anaesthesiol Scand Suppl 1961 ; 9.
- 21. Kouwenhoven WB, Jude JR, Knickerbocker CG. Closed chest cardiac massage. J Am Med Assoc 1960 ; 173 : 1064-7.
- 22. Le Galienne Richard. The Worshipper of the image ? New York & Londres, John Lane, 1900.
- 23. Rilke Rainer Maria. Les Cahiers de Malte Laurids Brigge (1910, 1929). Paris, Seuil, coll. Points 1980, p.72.
- 24. Bargue Charles et Gérome Jean-Léon. Cours de dessin, 1ère partie, modèles d’après la bosse, Paris, Goupil et Cie éditeurs, 1867, pl. 53.
- 25. Benkard Ernst. Das ewige Antlitz, Eine Sammlung von Totenmasken, mit einem Geleitwort von Georg Kolbe. Berlin, Frankfurter Verlags-Anstalt, 1926. édition anglaise : Undying faces : a collection of death masks. London, Leonard and Virginia Woolf at the Hogarth Press, 1929.
- 26. Pinet Hélène. "L’eau, la femme, la mort. Le mythe de l’Inconnue de la Seine", dans Le Dernier portrait, catalogue de l’exposition dirigé par Emmanuelle Héran. Paris, Musée d’Orsay, 2002, p. 175-190.
- 27. Sciolino E. At a family workshop near Paris, the "Drowned Mona Lisa" lives on. New York Times 2017. https://www.nytimes.com/2017/07/20/world/europe/paris-mask-picasso-truffaut.html
- 28. Tillier B La belle noyée. Enquéte sur le masque de l’Inconnue de la Seine. Les éditions Arkhé. Paris, 2011.
- 29. Bindé Joséphine. Beaux Arts n° 456 10 novembre 2021 site Internet.
- 30. Héran E. Le Dernier portrait. Catalogue de l’exposition, sous la direction d’Emmanuelle Héran. Musée d’Orsay, 2002.
- 31. Roret. Encyclopédie du Mouleur. L’Art de Mouler en Plâtre. Paris Librairie Encyclopédique de Roret 1838. Ce Manuel a été constamment réédité jusque dans les années 1920.
- 32. Blonde Didier. L’Inconnue de la Seine. Gallimard, Paris, 2012.
- 33. Grout M. Poèmes à l’Inconnue. Paris, Seuil, coll. "Pierres vives", 1945.
- 34. Loke S, McKernon SL. The face of CPR. BMJ 2020 ; 371 : m3899.
- 35. Céline Louis-Ferdinand. L’Église, Paris, Denöel et Steele, collection "Loin des foules", 1933.
- 36. Céline. Lettres. Choix de lettres de Céline et de quelques correspondants (1907-1961). Collection de la Pléiade. Paris, éditions Gallimard, 2009. p. 40 et 1679.
- 37. Pauli Herta. L’inconnue de la Seine. Berliner Tageblatt, 4 novembre 1931.
- 38. Vautrin R. L’Inconnue de la Seine. Intermédiaire des chercheurs et des curieux n° 185, juin 1967, pp.550-1, n°187, octobre 1967, n°189, décembre 1968.
- 39. Döblin Alfred. "Von Gesichtern, Bildern und ihrer Wahrheit", dans August Sander, Antlitz der Zeit, Sechzig Aufnahmen deutschen Menschen des 20. Jahrhunderts, Munich, Kurt Wolff, Transmare Verlag, 1929, p. 7-15.
- 40. Supervielle Jules. L’inconnue de la Seine dans l’Enfant de la haute mer. Paris, Gallimard collection Folio, 1972, p.65-82.
- 41. von Horvath Ödön. L’inconnue de la Seine (1933).Théâtre complet. Paris, L’Arche, 1996, vol.4, p.112-171.
- 42. Wiedemann Alfred K. L’Inconnue de la Seine Eine Erzâhlung. Breslau, Manuskript Verlag 1933.
- 43. Alvarez Alfred. Le Dieu sauvage, Essai sur le suicide. Mercure de France, Paris, 1972, p.163.
- 44. Muschler Reinhold Conrad. Die Unbekannte. Werner Plaut Verlag, Wuppertal Barmen, Deutschland, 1934. Munich, Wilhelm Heyne Verlag, 1978.
- 45. Nabokov Vladimir. L’Inconnue de la Seine. Poème, Berlin, 1934, traduit du russe par Bernard Kreise, Europe, n°791, mars 1995, p. 36-37.
- 46. Goll Claire. Die Unbekannte aus der Seine in : Zirkus des Lebens. Erzà¤hlungen. Berlin, edition des 2, 1976.
- 47. Aragon Louis. Aurélien. Paris, Gallimard, 1944.
- 48. Nin Anaïs. Houseboat in : Under a Glass Bell and other stories. Athens, Ohio UP, 1975, p. 32-44.
- 49. Cortàzar Julio Rayuela (titre anglais Hopscotch). éditeur : Catedra Ediciones 1963. édition anglaise en 1966.
- 50. Brenner Jacques. L’inconnue de la Seine. Paris, Albin Michel, 1968.
- 51. Blanchot Maurice. Une voix venue d’ailleurs. Paris, Gallimard 2001 (2002 en Folio Essais).
- 52. Cohen-Scali S. L’inconnue de la Seine. Paris, Rageot-éditeur, 1997.
- 53. Modiano Patrick. Des Inconnues. Paris, Gallimard, 1999.
- 54. Étienne Marie. L’Inconnue de la Loire. Paris, éditions La Table Ronde, 2004.
- 55. Musso Guillaume. L’Inconnue de la Seine. Paris, Calmann-Levy, 2021.
- 56. Zeidler Anja. A Reader’s Guide to William Gaddis’s The Recognitions. Influence and authenticity of l’Inconnue de la Seine. Site Internet williamgaddis.org
- 57. Cadou René-Guy Cadou. L’Inconnue de la Seine, poème Que la lumière soit (1949-1951), Poésie La vie entière. Œuvres poétiques complètes. Paris, Seghers, 2001, p.240-1.
- 58. Rodanski Stanislas. Je suis parfois cet homme. Paris, Gallimard, 2013.
- 59. Walter Céline. L’Inconnue de la Seine. Paris, Librairie éditions tituli, 2016.
- 60. Dockrill P. How a dead girl in Paris ended up with the most-kissed lips in history. ScienceAlert 2018. https://www.sciencealert.com/how-dead-girl-paris-ended-up-most-kissed-lips-in-history- l-inconnue-de-la-seine-resusci-anne-cpr-annie-death-mask.
- 61. Petiot F. L’Inconnue de la Seine et le surréalisme. Thèse Université Paris III, Sorbonne Nouvelle, 2000.
- 62. Sabryna Pierre. Opéra miniature. Incroyable, Inconnue, L’Inconnue de la Seine. Montreuil, éditions théâtrales, 2018.
- 63. Leutrat Jean-Louis, Liandrat-Guigues Suzanne. Alain Resnais. Liaisons secrètes, accords vagabonds. Collection Auteurs. Paris, Cahiers du Cinéma, 2006, p. 209.
- 64. Golovtchan C, Hakes A, Bouille F. L’Inconnue de la Seine, enquéte spatio-temporelle. Site Internet.
Références complémentaires
- Chopin Lesley, Frye Joy Beresford. The legend of L’Inconnue. A fascinating combination of legend and fact, imagination, musical storytelling and vibrant artwork.Verlag : Joyful Productions. 2012. Livre et CD musique.
- Chrisafis A. Ophelia of the Seine 2007. The Guardian 1er décembre 2007. https://www.the- guardian.com/world/2007/dec/01/france.art
- Grange J. Resusci Anne and L’Inconnue : the Mona Lisa of the Seine. BBC News 2013. https://www.bbc.co.uk/news/magazine-24534069.
- Lange André. L’Inconnue de la Seine. émission radiophonique septembre 2020. Site Internet : alfarrabiste.com
- Lista Giovanni. L’Inconnue de la Seine. Un plâtre de René Iché. Ligeia, 2015 (n° 141-144) : 21-22.
- Phelps M, Festa M. The most kissed lips in the world ? J Paediatr Child Health 2014 ; 50 : 748.
- Prévot Chantal. L’Inconnue de la Seine. In Mystères de Paris. Paris, Les éditions du Cerf, 2021, p.211-220.
- Privat-d’Anglemont A. Paris, Inconnu. Paris Adolphe Delahays, Libraire-éditeur, 1875. Fac-similé réédité en 2016 par les éditions Hachette Bnf.
- Rey Adrienne. L’Inconnue de la Seine, un fait divers devenu icône littéraire. 29 juin 2020. Site Internet Slate. : http://www.slate.fr
- Histoire radiophonique enquête policière INA 1 septembre 1973 L’Inconnue de la Seine (site Internet de l’INA).
- La noyée de la Seine qui inspira Aragon. 23 avril 2009. Au fil de la Seine revue n°31.
- Le Parisien du 22 septembre 2017. Arcueil : L’Inconnue de la Seine dope la célébrité de la société de moulage.
- TF1 reportage au journal télévisé en mars 2021.
Annexes
Annexe 1
Le dernier Portrait est une exposition qui a eu lieu au Musée d’Orsay (Paris) du 4 mars au 26 mai 2002 [1]. Le point de départ de l’exposition a été le livre de Maurice Bessy Mort où est ton visage ? (éditions du Rocher) publié en 1981. C’est un ouvrage de masques mortuaires photographiés sur un fond noir et classés par ordre alphabétique des personnages. Le masque ou le portait du défunt est réalisé pendant le bref délai qui sépare la mort de la mise en bière. Ces portraits ont surtout été réalisés au XIXe siècle. La tradition est ancienne et vient des portraits funéraires des rois et des saints. Un des premiers moulages post-mortem date de 1422 ; c’est celui du roi de France Charles VI. Le masque mortuaire de Charles VII est réalisé en 1461 et sert à Jean Fouquet pour réaliser le portrait définitif. À la fin du XVIIIe siècle la tradition du masque mortuaire se répand en Angleterre, en Allemagne et en France.
Référence
1. Héran E. Le Dernier portrait. Catalogue de l’exposition, sous la direction d’Emmanuelle Héran. Musée d’Orsay, 2002.
Annexe 2. La morgue de Paris
Si l’histoire du masque de l’Inconnue est intimement liée à la tradition du masque mortuaire elle l’est aussi au fonctionnement de la Morgue de Paris au cours de la deuxième moitié du XIXe siècle. Sise depuis 1804 sur le quai du Marché-Neuf, la Morgue est installée par Hausmann en 1864 sur le quai de l’Archevéché, à la pointe amont de l’Ile de la Cité, au chevet de Notre-Dame où elle fonctionna jusqu’en 1914, date de son transfert à l’Institut médico-légal quai de la Râpée [1]. La Morgue du quai de l’Archevéché est ouverte au public tous les jours de la semaine, matin et soir. L’exposition publique des cadavres a pour raison l’identification par les familles de l’individu décédé. Entre 1836 et 1846 la noyade est le mode de suicide de cinq femmes sur six [2]. Les corps sont exposés nus, les parties sexuelles cachées, allongés sur des tables en marbre légèrement inclinées. Les vétements sont accrochés à des patères au-dessus de la téte [Fig. 16 et 17].
Pour la conservation des corps est installé une irrigation avec de l’eau, puis à partir de 1883 une installation frigorifique. La Morgue attire une foule de curieux, de journalistes, de touristes venant voir les cadavres exposés derrière les vitres. C’est une attraction qui est indiquée dans les guides touristiques. En novembre 1876 l’exposition d’une femme coupée en morceaux et soigneusement recousue a attiré 200 000 personnes. Certaines années la Morgue reçoit un million de visiteurs. Tout le monde s’y rend, hommes, femmes et enfants. Victor Hugo l’évoque dans Choses vues : des gamins de la rue disent "Passons-nous à la Morgue ?". Émile Zola dans Thérèse Raquin chapitre 13 décrit la Morgue. Le héros du roman a précipité son rival dans la Seine. Il va tous les jours à la Morgue jusqu’à ce qu’il reconnaisse au milieu des cadavres celui de son rival. L’évolution de la médecine légale qui a développé des moyens scientifiques d’identification des cadavres (dont la photographie) conduit à la fermeture de la Morgue au public par un arrété du 15 mars 1907 signé par le préfet Lépine [3, 4].
Références
- 1. Bertherat Bruno. "La Morgue de Paris" , Sociétés & Représentations, "Violences" , n°6, juin 1998, p. 273-293.
- 2. Maillard F. Recherches historiques et critiques sur la Morgue. Adolphe Delahays, Libraire-éditeur, Paris 1860. Accessible via le site Gallica BnF.
- 3. Tillier B. La belle noyée. Enquéte sur le masque de l’Inconnue de la Seine. Les éditions Arkhé. Paris, 2011.
- 4. Blonde Didier. L’Inconnue de la Seine. Gallimard, Paris, 2012.
Annexe 3
Vladimir Nabokov
Poème L’Inconnue de la Seine publié en 1934
Hâtant de cette vie le dénouement,
N’aimant rien sur terre,
Toujours je regarde le masque blanc
De ton visage sans vie.
Dans les cordes se mourant à l’infini
J’entends la voix de ta beauté.
Dans les foules blêmes des jeunes noyées
Tu es plus blême et ensorcelante que toutes [...]
Annexe 4
Aragon, Elsa Triolet et Man Ray
Dans les années 60 Louis Aragon a le projet d’éditer les oeuvres de lui-méme et d’Elsa Triolet sous le titre Œuvres romanesques croisées d’Elsa Triolet et d’Aragon [1, 2, Chapitre 7 référence 2]. Il s’agissait d’une édition richement illustrée et qui devait comporter 32 volumes. Pour le roman Aurélien, Aragon (1ère édition en 1944) a demandé les illustrations à Man Ray. Quelques autres illustrations comportent des aquarelles de Marquet et des reproductions des nymphéas de Claude Monet. Man Ray réalise 14 variations photographiques sur le masque de l’Inconnue de la Seine [Fig. 30 et 31].

Avec Aurélien Aragon va ramener le masque au devant de la scène et doublement ancrer le mythe dans la littérature et la photographie. Aurélien, son héros, habite à la pointe de l’île Saint-Louis un appartement qui donne sur la Seine. Une reproduction du masque de l’Inconnue est accroché au mur de sa garçonnière. Désorienté après quatre années passées au front pendant la Seconde Guerre mondiale, il tombe amoureux de Bérénice le jour où il se rend compte qu’elle ressemble à l’Inconnue de la Seine quand elle ferme les yeux. Le roman est la description poétique de cet amour impossible.
Elsa Triolet dans le récit Ecoutez-voir [3-5] écrit :
« J’aimerais avoir un masque aussi beau que le sien, faire réver les jeunes gens, les yeux fermés, un demi-sourire qui frise à peine les lèvres, les cheveux en bandeaux ... Man Ray a photographié ce masque, lui ouvrant les yeux, vous pouvez voir cette image dans Aurélien d’Aragon : l’Inconnue vous regarde avec des yeux innocents, clairs, bouleversants, le mystère de la noyée se transforme, elle est rendue à la vie, le pire ne lui est pas encore arrivé ... ».
L’Inconnue de la Seine a accompagné Man Ray des années 1930 aux années 1960. En 1930 Man Ray réalise un photomontage appelé « Danger, dancer, avec l’Inconnue de la Seine ». Dans ce cliché l’Inconnue apparaît derrière un verre teinté [Fig. 42].

Une des photographies de 1930 est exposée à Anvers en Belgique en 1994 [Exposition Man Ray 1890-1976 du 18 septembre au 18 décembre 1994, Antwerpen (Belgique). Catalogue de l’exposition édité par Ronny Van de Velde, Antwerpen. Photo 75 intitulée « Dancer avec L’Inconnue de la Seine » 1930]. Une copie en plâtre du masque réalisée par Man Ray aux environs de 1960 a fait partie de la vente aux enchères de la succession de Juliet Man Ray organisée par Sotheby’s à Londres les 22 et 23 mars 1995 [Fig. 32].
Références
- 1. Saliot AG. L’Inconnue de la Seine : between early and late modernity (1898-2002) : text, image, crossings. Oxford Ph D. thesis, University of Oxford, 2008.
- 2. Saliot AG. The Drowned muse : The unknown woman of the Seine’s survivals from nineteenth-century modernity to the present. New York, Oxford University Press ; 2015.
- 3.Triolet Elsa. écoutez-voir. Gallimard, Paris, 1968.
- 4. Montier JP. Le masque de l’Inconnue de la Seine : promenade entre muse et musée, Word & Image, 2014 ; 30 : 46-56.
- 5. Montier JP. Elsa Triolet, de l’ère audio-visuelle à celle de la « post-vérité ». In : Lire Elsa Triolet aujourd’hui : à l’écoute du radar poésie sous la direction de Marianne Delranc et Alain Trouvé. Presses universitaires de Reims, 2017, p. 155-197.