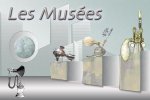Bartolomeo De Sanctis (1781-1830) est un personnage très curieux. Il naît à Rome en 1781. Il y passe sa thèse de médecine en 1802 à l’université de médecine, mais c’est en tant que professeur d’algèbre et de géométrie qu’il enseigne dans cette ville. Il perd sa chaire, en 1813, quand les troupes de Napoléon occupent la ville. Avec l’appui de son ami et protecteur, le baron Alexandre Humbolt (1769-1859), scientifique allemand, il est engagé comme médecin militaire dans les troupes néerlandaises. Un fois la paix revenue en 1815, il part en Angleterre, toujours comme médecin où il est admis au Royal College of Physicians de Londres le 30 septembre 1816. Avec l’appui du chirurgien Thomas Joseph Pettigrew (1791-1865) qui aidait les immigrés italiens à Londres, il bénéficie du Royal Literary Fund, fonds créés en 1788, pour aider les auteurs en difficulté. Il semble ensuite avoir été admis en 1829 à l’asile d’aliéné de Bethlem, après une tentative de suicide. Il meurt en 1830 [1]. De Sanctis se targuait d’être à la fois scientifique et littéraire. Il publia l’Ape Italiana a Londra, un périodique multiculturel destiné aux Italiens de Londres, écrivit des poèmes en italien et des pièces en latin. En médecine, un seul ouvrage de lui nous est connu. C’est un petit opuscule de 19 pages, écrit en latin sur un cas d’hermaphrodisme [2]. En outre il a écrit plusieurs lettres parlant du matériel qu’il a imaginé, pour la réanimation des noyés [3,4,5]. Ce matériel et le mode d’emploi sont largement repris dans les guides médicaux de 1820 et 1824 du médecin et pharmacien londonien Richard Reece (1775-1831) [6,7,8].
Le patient est installé sur ce que De Sanctis dénomme « the Reanimation Chair » avec la tête et les épaulées un peu relevées. La pile galvanique est suspendue à une potence, fixée au fauteuil. Un tube métallique qui sera relié à l’un des pôles électriques est introduit jusque dans l’estomac. Un tube d’argent est introduit dans le larynx et raccordé au système de soufflet. La bouche est soigneusement obturée avec un pansement enduit. Les narines sont fermées par une pince et les oreilles sont bouchées avec du coton ! La seconde électrode avec des chiffons humides est déplacée en différents endroits notamment au niveau du cœur, du diaphragme et de l’estomac, puis au niveau du cou sur le trajet du nerf phrénique et tout le long de la colonne. Pour l’utilisation de la pile, l’auteur recommande avant l’emploi, de tremper un doigt de chaque main dans le liquide pour en apprécier la force. Il insiste pour que tout le matériel nécessaire soit regroupé en un seul équipement avec le matériel de sauvetage recommandé par la Royal Humane Society of London.
Malheureusement, parmi les différents écrits, nous n‘avons trouvé aucune observation clinique de l’utilisation de ce matériel. Dans la foulée de ses premières publications, De Sanctis évoque les problèmes de la sonde gastrique en métal malléable, bien adaptée pour un chat, mais pas pour un homme de corpulence moyenne, et sonde qui présente un risque de rupture. Il pense la remplacer par une sonde en caoutchouc entourée d’un fil métallique en spirale, mais trop molle pour l’introduction, il lui préfère une sonde en cuir de Russie. Ces éléments laissent sceptique sur la réalité de l’utilisation de son matériel, même si De Sanctis, le dit disponible au Medical Hall 171, Picadilly… qui est en fait la boutique de Richard Reece. la pile pouvant elle, être achetée chez Charles Massi, 2 Victoria place, Londres [3-5]

Sur cette image reprise et agrandie, on voit la pile suspendue, (1) reliée à la sonde gastrique, avec son électrode cutanée en chiffon humide (3). La sonde laryngée en argent, légèrement conique est couplée au soufflet (2). La bouche est solidement obturée par un pansement ne laissant passer que les sondes et fixé en arrière avec des élastiques. Les narines sont pincées.
La première réanimation efficace connue d’un humain, par des chocs électriques, date du 16 juillet 1774. C’est l’histoire de Catherine Sophie Greenhill, une petite fille âgée de 3 ans, tombée d’une fenêtre d’escalier sur des pavés. Elle fut déclarée morte sans espoir par un apothicaire appelé sur les lieux. Mais un voisin passionné d’électricité, monsieur Squires de Soho, proposa avec l’accord des parents de tenter des chocs électriques à partir d’une bouteille de Leide. Les premiers chocs appliqués en divers endroits furent inefficaces, puis quelques petits chocs sur la poitrine furent couronnés de succès. Les battements cardiaques reprirent, puis la respiration et l’enfant survécu. Après quelques jours d’un état un peu stuporeux lié à son traumatisme crânien, la fillette reprit une vie normale [9,10]. Dans ce contexte, le chirurgien britannique John Hunter (1728-1793) écrit qu’il ne sait pas comment agit l’électricité, mais qu’elle doit être essayée, quand les autres moyens ont failli [11]
En 1775, Peter Christian Abildgaard (1740-1801), médecin, vétérinaire et naturaliste danois, a montré, en expérimentant sur des poules, l’intérêt d’un choc électrique pour la reprise d’une activité cardiaque. Après avoir rendu les volailles sans vie par un choc électrique, il réussit à les réanimer complétement par un nouveau choc sur la poitrine [12,13]. En 1783, Christoph Wilhelm Hufeland, (1762- 1838) premier médecin du roi de Prusse Frédéric III a proposé l’utilisation de chocs électriques, dans l’asphyxie des nouveau-nés. Il place une électrode au niveau des vertèbres cervicales, et l’autre sur le creux épigastrique, pour stimuler le nerf phrénique [14,15]. Pour Giovanni Aldini (1762-1834) physicien italien et neveu de Galvani, en 1804, ce sont les muscles qu’il faut stimuler, car leurs contractions faciliteraient la circulation sanguine. Le courant est appliqué entre une oreille et de l’eau salée dans laquelle est trempée la main du noyé à la base de la cuve galvanique [16].
Le courant entre l’oreille et la main selon Aldini
En 1809, Allan Burns, 1781-1813, professeur de chirurgie à Glasgow propose dans son ouvrage sur les pathologies cardiaques, d’associer à la ventilation assistée, un choc électrique externe sur le thorax, pour les morts subites [17]. James Curry (1762-1819) formé à Edinburgh et qui a beaucoup travaillé sur ces morts apparentes, pense que l’organe cible est le cœur : il place les électrodes sur la clavicule droite et aux niveaux des dernières côtes gauches, alors que les poumons sont insufflés pour faciliter la circulation pulmonaire [18]. Alors que Alexander Philips Wilson Philip (1770-1847) médecin et physiologiste d’Édimbourg préconise à la même époque, le choc électrique sur les poumons, dont la mécanique favorisera la circulation [19]. Lorsque De Sanctis propose son concept et son matériel, la manière d’utiliser l’électricité n’est pas vraiment codifiée.
Premières réanimations par électrostimulation
Les chocs électriques proposés pour la réanimation des sujets en état de mort apparente, évoquent plutôt des cardioversions avec la possibilité d’effets délétères. Curry précise d’ailleurs que les chocs électriques ne doivent être tentés qu’en dernière extrémité, après plus d’une heure d’échec des autres manœuvres. Il précise aussi que le sujet doit être isolé, allongé sur une porte reposant sur quatre bouteilles, témoignant ainsi d’une intensité forte du courant [18]. L’utilisation de la sonde introduite dans l’estomac proposée par De Sanctis peut faire penser à une forme de stimulation de l’oreillette gauche, avec des courants de plus faible intensité comme l’indique le test de l’opérateur avec ses doigts dans la pile.
La pile suspendue, relativement facile à manier est une nouveauté pour l’époque, bien qu’elle dérive de la cuve galvanique perpendiculaire d’Albini [3,16]. C’est une batterie pouvant être montée en quelques minutes dans une mallette de transport, qui plus est, rapidement rechargeable.
Enfin la notion d’avoir tout le matériel nécessaire réuni autour des points d’eau paraît une évidence.
L’invention de Bartolomeo de Sanctis, ne connaîtra pas un grand intérêt. En 1828, Reece dans son Medical Guide, ne lui accorde plus que quelques lignes : « Dr De Sanctis, un éminent praticien de Londres, a récemment inventé un appareil galvanique bon marché, qui est accompagné d’instructions pour permettre à toute personne de l’utiliser » [20]. Quant à la Royale Humane Society of London, la même année, elle ne parle plus de choc électrique pour les noyés, mais uniquement pour les personnes foudroyées [21].
Bibliographie
- Victoria Research Web : Dr Bartolomeo De Sanctis. In : Biographies on some obscure contributors to 19th-century Periodicals. http://victorianresearch.org/Obscure_contributors.html - consulté 07 mai 2024.
- Sanctis AB de. Lusus naturae. Londini observatus descriptus, tabula et notis insuper illustratus, Londin, Schultze et Dean, 1817, 19p.
- Sanctis AB de. Galvanisme, letter to Professor Aldini. The Monthly Gazette of Health. 1819 ;4:277-9, 312-3, 359-60 et 1820 ;5:422-4 et 442-4.
- Sanctis AB de. Galvanism. The Monthly Gazette of Health 1820 ; 5:518-9.
- Sanctis AB de. The following Plan for Restoring Persons from a state of suspended Animation, is humbly offered to the public. London Medical Repository, 1820 ;13 : 268-70, 360-1 et 534-7
- Reece R. On suspended animation and of recovery. In : The Medical Guide…13e ed, London, Longman, Hurst, Rees, Orma and Brown, 1820, pp 100-109.
- Reece R. On suspended animation and of recovery. In : The Medical Guide…14e ed, London, Longman, Hurst, Rees, Orma and Brown, 1824, pp 107-114.
- Schechter DC. Early experience with resuscitation by means of electricity. Surgery, 1971 ;69(3):360-72.
- Plan and reports of the Society for the Recovery of Persons Apparently Drowned. 1774, p 32.
- Paets Van Troostwyk A, Krayenhoff, CRT. De l’Application de l’électricité à la physique et à la médecine. Amsterdam, J.Changuion, 1788, pp 245-7.
- Hunter J. Proposals for the recovery of people apparently drowned. Phil. Trans. R. Soc. 1776 ;24 :412–425.
- Abildgaard, P.C. Tentamina electrica in animalibus instituta. Soc. Med. Havniensis Collect. 1775, 2, 157–161.
- Driscol TE, Ratnoff OD, Nygaard D. The Remarkable Dr. Abildgaard and Countershock : The Bicentennial of His Electrical Experiments on Animals. History of Medicine, 1975 ;83(6):878-82.
- Hufeland CW. Usum vis electricae in asphyxia. Gottingae, Joann Christian Dietrich, 1783, 59 p.
- Althaus J. A treatise in medical electricity. London, Longmans Green and co, 1873, p 592.
- Aldini J. Application du galvanisme aux noyés, et aux différentes espèces d’asphyxies. In : Essai théorique expérimental sur le galvanisme. Paris, Fournier et fils, 1804, pp 116-21.
- Burns A. Observations of some of the most frequent and important diseases of the Heart. Edinburgh, Thomas Brice & co, 1809, pp 147-8.
- Curry J. Observations on apparent death from drowning…London, E Cox and son, 1815, pp 63-66.
- Philip APW. On Suspended Animation. In : An experimental inquiry into the laws of the vital functions. 2nded, London, Thomas & Georges Underwood, 1818, pp 358-61.
- Reece R. On suspended animation and of recovery. In : The Medical Guide…15e ed, London, Longman, Hurst, Rees, Orma and Brown, 1828, p 180.
- The fifty fourth report of the Royal Humane Society. London, JB Nichols and son, 1828, 126p.