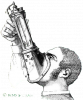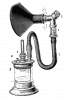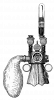L’histoire de la création des services de secours aux blessés de la route reste toutefois peu connue, et surtout peu étudiée. L’Automobile-Club Médical de France s’est intéressé dès sa création, en 1952, aux rapports entre la médecine, la santé et l’automobile, mais aussi aux moyens de faire diminuer le nombre et la gravité des accidents de la route. Pour cette raison, il a souhaité, en 2008, lancer une recherche et préparer une publication sur l’histoire de la « médecine routière », basée notamment sur le recueil de nombreux souvenirs et témoignages des « pionniers » de ce combat, entamé à une époque où la population comme les pouvoirs publics étaient d’une part très démunis, et d’autre part peu sensibilisés à ces enjeux. Cette communication est issue de ce travail historique, lequel sera publié en novembre 2010.
Les premiers médecins à s’intéresser sérieusement aux accidents de la route, et ce n’est bien sà »r pas un hasard, ont été des chirurgiens et des anesthésistes- réanimateurs. Ces médecins étaient en première ligne, dans les hôpitaux, pour recevoir les blessés de la route, et prirent conscience, très vite, de l’importance des premiers secours et premiers gestes, sur le lieu méme de l’accident, avant méme le ramassage et le transport, lequel devient bien sà »r obéir aussi à des règles strictes.
Si le Pr Maurice Cara, à Paris, fut le premier à transporter en ambulance, sous respirateur, des grands malades sur de grandes distances, c’est le Pr Paul Bourret qui créa en 1957, à Salon-de-Provence, la première « antenne chirurgicale » pour les accidents de la route, destinée à leur prodiguer, sur le lieu méme de l’accident, les premiers soins médicaux puis d’organiser leur ramassage et leur transport. En 1961, un chirurgien marseillais, le Pr Marcel Arnaud, publiera, lui, le premier ouvrage pratique sur les secours aux accidentés de la route, et montrera surtout la spécificité de ces blessés, et les moyens de mieux les prendre en charge. Cette époque voit aussi la structuration de l’anesthésie-réanimation en tant que spécialité à part entière, avec une meilleure codification de ses missions dans la chaîne des soins et l’organisation hospitalière.


En 1986, c’est grâce au Pr Louis Lareng, qu’une loi généralisera enfin les SAMU dans tous les départements français, loi qui s’inspire largement de l’expérience des médecins accumulée au cours des trois décennies précédentes. Indéniablement, l’expérience accumulée par les médecins dans la prise en charge des accidentés de la route et dans l’organisation des structures de secours à ces derniers a constitué la base d’une médecine d’urgence s’adressant à des catégories plus larges de blessés et de malades. Alors que les urgences « routières » constituaient, jusque dans les années 1970, la majorité des interventions de ces services, elles ont petit à petit diminué au profit d’autres types de sorties, et notamment des urgences médicales, qui dominent désormais largement les interventions. Elles n’en restent pas moins la base de toute l’organisation de la médecine d’urgence, et un regard historique sur la prise en charge des accidentés de la route permet donc de mieux comprendre l’évolution de la médecine d’urgence actuelle.

Enfin, au-delà des sorties sur le terrain, les spécialistes de la « médecine routière », dont beaucoup d’anesthésistes réanimateurs et de chirurgiens, furent parmi les premiers à réclamer des véhicules et des routes plus sà »res, mais aussi des mesures préventives comme les limitations de vitesse, la lutte contre l’alcool au volant ou l’obligation du port de la ceinture de sécurité. Au-delà des soins, ils ont ainsi joué un rôle de premier plan dans la lutte contre la mortalité routière €“ divisée par 4 entre 1972 et 2010- et oeuvré pour faire entrer la prévention des accidents de la route dans le champ de la santé publique, au méme titre que les autres grands fléaux sanitaires.